
 Mireille KERLAN est orthophoniste et chargée de mission éthique à la Fédération nationale des orthophonistes (FNO). Elle est l’auteure de l’ouvrage Éthique en orthophonie, Le sens de la clinique paru en 2016.
Mireille KERLAN est orthophoniste et chargée de mission éthique à la Fédération nationale des orthophonistes (FNO). Elle est l’auteure de l’ouvrage Éthique en orthophonie, Le sens de la clinique paru en 2016.
Après avoir lu cet ouvrage passionnant, fruit de longues années d’expérience de clinicienne et de formatrice, j’ai demandé à Mireille KERLAN de m’accorder une interview.
Cet échange est divisé en deux articles. Le premier présente l’auteure et se penche sur les questions d’éthique, de déontologie, la reconnaissance de la coordination des soins, les moyens de prendre soin de soi quand on est soignant, les termes de « rééducation », de « rencontre ».
Ce deuxième article se concentre maintenant sur la question de l’accueil du patient, sur le principe d’autonomie et l’éducation thérapeutique, le courant de l’evidence based practice (EBP), la question de la narration, et les soins palliatifs.
J’aimerais vous poser une question sur la pratique clinique : le moment de l’accueil du patient. Vous parlez de l’importance éthique de la première rencontre qui se fait le plus souvent par contact téléphonique. Ce contact sert à rassurer le patient : la prise en soin commence par la prise en charge et l’écoute de son angoisse.
Je suis tout à fait d’accord sur le principe, mais la réalité du terrain clinique rend parfois cette première rencontre bien compliquée.
Les orthophonistes devraient-ils laisser leur téléphone allumé et répondre aux demandes de rendez-vous de nouveaux patients lorsqu’ils ont déjà un patient devant eux ?
C’est une question qu’on a beaucoup débattu par rapport à la charte. En effet, l’accueil du patient se fait dès qu’on décroche le téléphone. Personnellement je ne réponds pas pendant les consultations, ou alors très rapidement et je leur demande si je peux les rappeler dans les vingt-quatre heures. On a aussi un répondeur sur lequel on annonce que pour un premier bilan il faut rappeler à une plage horaire que nous avons définie et à laquelle nous sommes disponibles pour répondre. Le principe est de ne pas mélanger la consultation avec un patient et les demandes téléphoniques.
Quand on rappelle ou qu’on répond à la personne qui demande un rendez-vous, il faut réfléchir à notre réponse qui ne doit pas être juste une réponse banale qui dit seulement qu’il n’y a pas de disponibilités avant six mois ou un an. Il faut se mettre à la place du patient qui nous appelle. Si nous, on appelait un médecin ou un psychologue qui nous disait ça, comment on réagirait ? On peut essayer de répondre d’une autre façon. Le ton, la façon dont on va répondre, comment on va débrouiller la demande, comment on va se dire si c’est urgent ou pas : cela est très important. D’ailleurs en orthophonie on n’a que très peu d’urgences au sens d’urgences vitales (dysphagies…), mais il peut y avoir des urgences fonctionnelles. Il s’agit avant tout de prendre en charge l’angoisse du patient ou de ses proches, comme cela peut être le cas chez une maman dont l’enfant de trois ans ne parle toujours pas. Dans ce cas-là on va essayer de ne pas faire le bilan dans six mois. Si on ne peut pas prendre le patient, on va lui demander s’il souhaite être inscrit sur notre liste d’attente ou s’il souhaite nous rappeler plus tard s’il ne trouve pas d’autre collègue pour le recevoir. On peut trouver d’autres solutions, par exemple décider que les orthophonistes du cabinet répondent à tour de rôle pour débrouiller la demande et répondre aux parents qui s’affolent…
Quand je travaillais à plein temps, je ménageais un temps dans mon emploi du temps pour les gens qui arrivaient en urgence. J’ai fait aussi beaucoup de rééducations vocales, qui s’étendaient sur quelques semaines ou quelques mois, donc j’avais des patients qui tournaient, je n’étais pas bloquée. De plus j’avais un temps pour réaliser des bilans. C’est une question d’organisation. Je sais qu’en ce moment c’est hyper complexe, on est bloqués partout, surtout en zone rurale…
C’est compliqué car cela se joue au cas par cas. La question de l’urgence, tous les orthophonistes se la posent. La question de l’organisation des plannings, de l’emploi du temps, n’est pas simple non plus. C’est un vrai casse-tête pour tous les orthophonistes.
Dans tous les cas je pense quand même qu’on doit s’organiser de manière à prendre un temps pour répondre aux gens de façon à entendre et accueillir leur demande, et à les rassurer.

Vous citez la maxime de Kant : « Agis comme si la maxime de ton action devait être érigée en loi universelle. » Cette maxime porte sur le principe d’autonomie de la personne, c’est un principe qui rappelle que chacun doit agir en fonction de sa raison et non de ses émotions. Or dans la relation soignant-soigné, chaque cas est particulier. Cette maxime d’autonomie qui se veut universelle est-elle vraiment applicable à chaque patient ?
Kant est à l’origine d’une loi très présente maintenant dans notre métier : la loi de 2005 sur l’autonomie du patient, que nous devons respecter. Dans cette loi sont inscrits le fait d’informer le patient, tout en respectant son intimité. C’est aussi respecter le choix du patient : s’il décide de continuer ou d’arrêter un traitement, on n’a pas à lui dire qu’il a tort. En même temps ce n’est pas si simple que ça. L’éthique nous permet justement de démêler tout ça, parce que si on choisit uniquement de respecter la loi en se référant aux textes de manière très stricte, on n’est bien ni l’un ni l’autre. Or le but n’est pas là.
Les émotions interviennent tout le temps dans le soin orthophonique, que ce soit pour annoncer un diagnostic, donner des exercices au patient ?
Oui tout à fait. Mais il faut les contrôler, les intégrer au raisonnement de soin.
Nous, soignants, sommes dans des métiers où on est très proches humainement des patients et où les émotions sont présentes. Damasio a d’ailleurs montré qu’il y a un lien entre la raison et les émotions. On peut aussi entendre le terme « émotion » comme étant de l’intuition.
J’ai quelques questions sur l’éducation thérapeutique du patient (ETP). L’ETP consiste à rendre le patient le plus autonome possible, et si possible à le rendre acteur de sa prise en charge et de sa santé. Vous nous donnez des pistes pour mieux comprendre cette notion d’autonomie. A la page 137, vous parlez des trois niveaux d’autonomie du patient à respecter, que distingue Bernard Baertschi : l’autonomie de la personne, l’autonomie de la volonté et l’autonomie de la décision ou de l’action.
L’autonomie de la personne est le fait que cette personne possède une dignité humaine quelles que soient ses capacités cognitives.
L’autonomie de la volonté est la capacité du patient de choisir, décider et consentir à la thérapie.
L’autonomie de la décision ou de l’action relève du consentement libre et éclairé comme c’est le cas en bioéthique.
Pourriez-vous revenir sur la différence entre ces deux derniers niveaux d’autonomie ? Est-ce que le dernier niveau concerne uniquement les questions de bioéthique ?
L’ETP consiste-t-elle à favoriser ces différents niveaux d’autonomie ? Si oui, pouvez-vous me donner des exemples d’ETP réussis ?
Sur internet vous devez avoir accès à la bibliographie de mon livre, où il y a des textes sur l’éducation thérapeutique qui sont très intéressants. On parle du « patient sachant » : c’est un patient dont on prend en compte l’expérience et qui peut se prendre en main, comme le patient diabétique qui peut gérer ses soins au cours de la journée, puis cela a été décliné à d’autres pathologies. L’ETP c’est éduquer le patient chronique à être autonome dans ses décisions et dans la conduite de sa thérapie.
On trouve aussi sur le site de l’HAS des recommandations sur l’éducation thérapeutique du patient. C’est intéressant car des patients peuvent se prendre en charge eux-mêmes et libérer des places dans les cabinets. Cela commence à se faire. Frédérique Brin, orthophoniste et chercheur en Lorraine, pratique l’éducation thérapeutique des dysphagiques et des aphasiques. Elle travaille en MPR (médecine physique et réadaptation), elle a pu monter des projets sur ce sujet et elle fait également des formations. Il y a encore peu d’orthophonistes qui gèrent des programmes d’ETP. Cela progresse même si pour le moment les possibilités pour la pratique de l’éducation thérapeutique en libéral, sont compliquées avec des dossiers longs à monter.
Il y a 4 ou 5 ans, j’ai découvert un concept très intéressant : l’éducation thérapeutique intégrée aux soins de premiers recours, en fait ce qu’on fait tous les jours, mais ça n’a pas été développé par la suite. Je pense que même si on ne fait pas d’éducation thérapeutique au sens institutionnel, l’ETP peut nous aider dans la rééducation. Cela veut dire qu’il faut donner un savoir au patient, l’informer sur sa pathologie et sur ce qu’il faut qu’il fasse pour qu’il soit autonome même s’il ne guérit pas. Là encore on est dans le dialogue, dans l’échange.
En ce qui concerne l’autonomie, il faut savoir à partir de quand l’humain est autonome. C’est une question complexe qui est beaucoup développée par la philosophie, en particulier Kant et Rousseau. Chacun est autonome de sa vie, on « mène sa vie », c’est le propre de l’être humain… On rencontre ce problème chez les gens très handicapés ou les gens en fin de vie, chez les gens qui n’ont plus de fonctions cognitives.
L’autonomie c’est aussi, en fonction du contexte où je suis, est-ce que je peux décider ou pas ? Par exemple une personne qui a un cancer peut se poser la question de choisir ou de refuser la chimiothérapie.
La décision de l’action concerne la décision dans l’action. Dans ce cas, on n’est plus dans l’attente ou dans le subir.
Par exemple, ce serait le cas du patient dysphagique qui va appliquer les conseils donnés par l’orthophoniste ?
Oui.
C’est aussi les conseils donnés par l’orthophoniste aux aidants pour les aider à adopter des comportements qui permettent de continuer à communiquer avec le malade ?
Oui. Par exemple un couple dont l’un est aphasique peut continuer à communiquer parce qu’on leur a donné des clés, ils n’attentent pas tout de l’extérieur, ils peuvent vivre, voyager, de nouveau continuer à donner un sens à leur vie… Quand on est dans l’action, on va au-delà du fait de dire « je vais bien » ou « je ne vais pas bien », on va vraiment agir pour mener sa vie dignement.
C’est un niveau d’autonomie supérieur mais tous les patients ne peuvent probablement pas y avoir accès…
Effectivement. C’est comme quand vous avez des enfants, il faut se poser les bonnes questions. « Quel est le projet ? Pourquoi je suis là, pourquoi je fais ça ? »
Par exemple à un enfant dyslexique, on va proposer des exercices, en fonction du projet pour lui, et en fonction de nos savoirs. Quand vous faites un projet avec un patient, l’objectif est qu’il soit autonome. Il faut avoir en tête qu’un enfant deviendra adulte, donc de quoi aura-t-il besoin pour compenser sa dyslexie, par exemple. Avec des adolescents qui viennent me voir tardivement, je ne vais agir comme avec un petit enfant de 7ans.
Un exemple extraordinaire : un jeune adolescent en 3ème. Les professeurs le traite de paresseux, et disent à ses parents qu’ils ne le font pas travailler alors que ce n’était pas du tout le cas. Ce garçon, quand on lui présente une liste de mots, lit certains mots très vite car il possède un bon lexique, mais il est incapable de déchiffrer des mots simples comme « domino »inconnus dans son lexique. Il n’avait aucune capacité d’association consonne-voyelle. Personne n’a repéré sa dyslexie. Il est en grande souffrance et fait de la phobie scolaire. Un jour un de ses professeurs lui parle de dyslexie. Avec lui j’ai travaillé de manière très pragmatique sans reprendre tout à la base et en le rendant acteur de sa rééducation. Il m’a posé des questions pour pouvoir s’adapter à sa scolarité. Un jour il faudra peut-être revenir à cette histoire de déchiffrage. Je me suis posé la question : « Quel projet par rapport à lui ? ». Bien sûr derrière tout ça il y a un savoir : je connais les modèles linguistiques de fonctionnement du langage… Il y a un mélange entre savoir théorique et réalité pratique… Il faut savoir s’adapter à chaque patient. Cela demande quand même d’être solide sur le plan scientifique.
Par ailleurs je pense qu’il ne faut pas nécessairement respecter une méthode ou un protocole tout fait. A chaque fois il faut réfléchir, adapter mais pas s’inscrire dans un modèle unique. Cela tient peut-être à ce que je suis de la génération de 1968 ! J’ai été dans les premières étudiantes en orthophonie à faire mon mémoire sur la dyscalculie avec Francine Jaulin-Mannoni que beaucoup ne connaissent plus mais qui est à l’origine des courants logico-mathématiques en orthophonie. Elle créait beaucoup et comme Denise Sadek cherchait au fur et à mesure pour répondre aux besoins du patient et non pour suivre une procédure fixe.
Je trouve que la transversalité dans notre métier est intéressante : ce que je vais apprendre sur la voix va me servir pour les problèmes de dysphagie ou autre. Cela tient aussi à ma pratique de l’orthophonie. Après mon diplôme et quelques années de pratique à Paris, je suis arrivée dans un département où il n’y avait pas une seule orthophoniste, j’ai eu affaire à toutes sortes de demandes, des choses que je n’avais jamais vues, jamais faites, et je ne pouvais pas dire non. Les gens n’avaient pas d’autre choix ou alors ils n’allaient pas voir d’orthophoniste. C’étaient par exemple des enfants avec des fentes palatines opérées tardivement qui parlaient mal, qu’on ne comprenait pas, des enfants sourds, des laryngectomisés, etc… J’ai eu aussi des demandes pour des aphasiques, or j’en avais très peu vus. Je ne pouvais pas orienter les gens vers une collègue puisque je n’en avais pas. Je me suis donc beaucoup formée pour pouvoir mieux connaître tous les domaines de l’orthophonie.
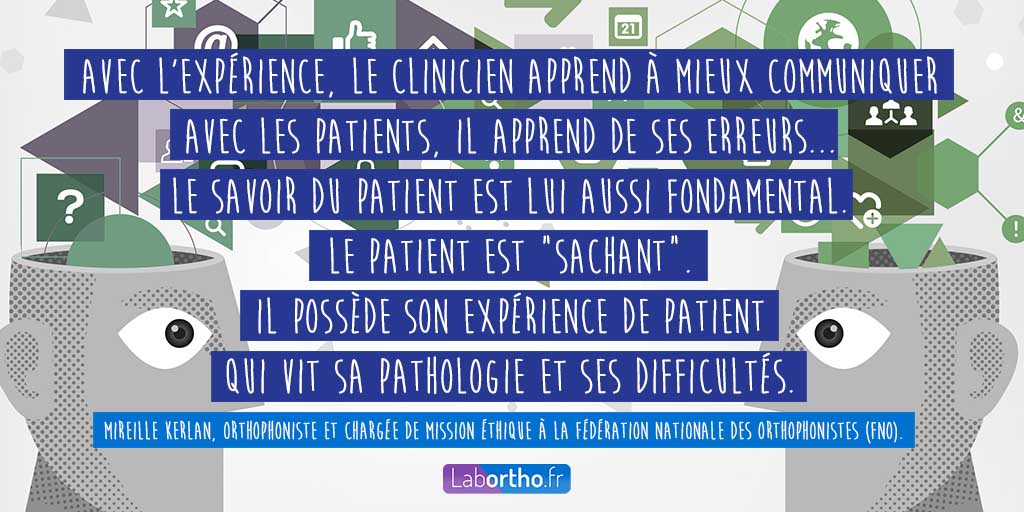
Vous dites que le vécu du patient ne peut être appréhendé par « aucune évaluation normée, aucune échelle de qualité de vie ». Le vécu du patient, central dans tout projet thérapeutique, ne peut-il faire l’objet d’une évaluation ?
Les échelles de qualité de vie, les tests sont intéressants : ils nous guident mais ne sont pas suffisants. Dans la rédaction d’un compte-rendu de bilan, et aussi pour parler du bilan au patient et à sa famille, on ne peut pas se référer uniquement à des chiffres. Ma position n’est pas de refuser les résultats chiffrés, d’ailleurs ma position n’a jamais été de vouloir « psychologiser » l’orthophonie comme le font certains courants.
A propos des preuves qu’on nous demande, les données probantes, il y a deux choses que je voudrais dire. D’une part on est sous l’influence politique de normes et de chiffres qu’on nous impose de plus en plus. Ce n’est pas facile mais je pense qu’il faut lutter contre cela. C’est plus facile peut-être dans nos métiers d’orthophonistes parce qu’on a une grande autonomie dans le choix de ce qu’on fait, dans le choix de nos outils, de la façon dont on pose un diagnostic, dans notre projet de soins. D’autre part il y a une très mauvaise interprétation de l’EBM et de l’EBP, car les données probantes ne sont pas les seules à prendre en compte. L’expérience du clinicien est aussi à prendre en compte, au sens philosophique de John Dewey ou de Schön qui parle de réflexivité et de personne. Avec l’expérience, le clinicien apprend à mieux communiquer avec les patients, il apprend de ses erreurs… Le savoir du patient est lui aussi fondamental. Le patient est « sachant » : il possède son expérience de patient qui vit sa pathologie et ses difficultés. L’EBP, ce sont ces trois sources de savoir à égalité l’une avec l’autre : données de la littérature, expérience du clinicien, savoir du patient.
Une question à présent au sujet de la précision de la notion de « narration ». Dans cette notion que vous développez dans votre ouvrage, je comprends qu’elle regroupe l’écoute du vécu du patient, de son histoire, de son identité. Est-ce bien cela dont il s’agit ?
La narration sort-elle complètement du domaine de l’évaluable ?
Oui, tout à fait. La notion de narration tire son origine de l’éthique narrative. C’est une réflexion née aux États-Unis en réaction à une pratique trop simpliste où seuls les principes de bioéthique étaient pris en compte. Il a alors été institué pour les médecins une formation basée sur l’étude narrative. Les médecins ont réfléchi à partir de récits littéraires d’écrivains comme Tchekhov où sont développés la relation avec la personne. Ce courant est d’ailleurs actuellement introduit en France dans certaines facultés de médecine. L’objectif était de faire prendre conscience aux médecins de la complexité humaine, et que l’histoire de la maladie est liée à cette complexité humaine. Par exemple, une personne qui a un cancer, il y a tout ce qu’on peut mesurer, voir avec l’imagerie, mais cela ne suffit pas, car chaque personne va évoluer et réagir à la maladie de façon différente.
Je pense à un patient que j’ai vu à l’hôpital. Il s’agit d’un monsieur qui a fait une gangrène et qui aurait pu en mourir. Il a une force de vie telle que le personnel médical en est étonné. Je le vois car le nerf hypoglosse a été touché. Il a du mal à avaler et à parler, et en dix jours il a déjà fait des progrès énormes. Je lui ai montré des exercices, expliqué les consignes pour bien avaler ; mais je pense que ce cas clinique montre que la technique ne suffit pas. D’autres facteurs jouent : ce monsieur a sa femme qui fait 50 km par jour pour venir le voir à l’hôpital, c’est un couple heureux après plus de quarante ans passés ensemble. Il cherche à être le plus autonome dans tous ses soins. Il saisit les occasions pour faire des exercices et fait des projets réalisables sans se plaindre. Ça marche. Mais les mêmes exercices avec un autre patient, dans un autre contexte ne donneraient pas forcément les mêmes résultats.
La narration, ne serait-ce pas aussi laisser la place dans la séance à l’expression du vécu du patient, par rapport à sa pathologie et à sa prise en charge orthophonique ? La narration fait partie intégrante de la thérapie orthophonique. Faut-lui réserver des moments pendant la séance, faut-il la laisser venir, la susciter ?
Oui tout à fait. Les temps ne sont pas obligatoirement séparés et la narration peut ne pas intervenir dans toutes les séances. Elle accompagne la thérapie. C’est là qu’on peut parler d’échange : entre ce qu’on va apprendre au patient et ce qu’il va nous apprendre de lui.
Une question fréquente est « comment, quand, arrêter un soin ? » : la décision sera une co-décision conduite par la narration. Une personne lors d’une formation d’aidants de personnes aphasiques avait raconté que l’orthophoniste avait décidé unilatéralement d’arrêter la rééducation de son époux. Cela avait été très choquant pur le couple et ils se sentaient abandonnés. L’orthophoniste avait peut-être raison d’arrêter le suivi par rapport à ce qu’elle pouvait proposer, mais cela aurait mérité un échange, cela aurait dû passer par la narration.
La narration c’est essayer d’expliquer, de voir ce que le patient comprend ou pas, de savoir ce qu’il pense, de faire que la décision sera prise ensemble. Cela sera mieux accepté et la suite de sa vie pourra continuer à se construire malgré la maladie ou le handicap. Je ne dis pas que c’est facile. Il y a parfois des choses que les gens ne comprennent pas, ou n’admettent pas.
D’autre part, le thérapeute est parfois confronté au risque de nuisance des patients envers les soignants. Je pense à certaines familles très méfiantes envers les professionnels de santé, notamment en maison de retraite. Ce sont des familles qui tendent à s’imposer, à prendre l’énergie du personnel… Si le thérapeute doit en premier lieu ne pas nuire à son patient, en retour le patient doit faire confiance au thérapeute pour que leur relation soit vivable, que cette relation se passe dans des conditions acceptables pour les deux parties. Comment instaurer la confiance ou la reconstruire lorsque celle-ci n’est pas d’emblée évidente ?
A propos des familles dans les maisons de retraite, c’est effectivement parfois difficile. Si on en parle, on se rend compte que c’est une énorme souffrance, et cette souffrance-là, elle passe par des tas de comportements. Le dialogue est indispensable, et en tant qu’orthophonistes, on est bien placés pour dialoguer. Si le patient est agressif ou n’a pas bien vécu certains propos, il faut essayer de comprendre pourquoi il les a vécus comme ça. Quand on en parle on arrive à dénouer des choses.
Par exemple, quand on annonce un diagnostic à un patient, même s’il l’attend et qu’il est content parce que ça le conforte dans ce qu’il pensait, c’est violent quand même. Si vous annoncez à une famille que leur enfant est bien dyslexique, vous pouvez voir leur réaction et vous pouvez voir qu’il y a un avant et un après. Cela s’explique parce que la narration intervient dans un récit de vie que la personne s’est construite. La pathologie fait intrusion dans ce récit de vie, et nous il faut qu’on arrive à retricoter un récit de façon à ce que la personne puisse continuer à avoir envie de vivre, de faire les soins et surtout d’avoir du goût à vivre.
L’anamnèse est un moment privilégié pour la narration…
A propos de l’anamnèse, on a tendance aujourd’hui à poser des questions un peu rapides, auxquelles on attend des réponses par oui ou non, et je trouve que ce n’est pas suffisant. C’est un moment privilégié pour la narration et cela va nous permettre d’y trouver les éléments nécessaires à la compréhension de la pathologie.
Dans votre livre vous faites une place aux problématiques soulevées dans les soins palliatifs, pouvez-vous nous en dire un peu plus par rapport à votre pratique ?
J’ai une pratique très généraliste même si je vois actuellement plus de patients atteints de troubles neurologiques … Je ne suis pas du tout gênée pour travailler avec des patients adultes âgés et donc nous sommes confrontés à la question de fin de vie. Je pense que notre rôle est d’accompagner la communication le plus longtemps possible. Par exemple j’ai suivi des patients atteints de SLA pour qui il fallait trouver des moyens de communication, et on est allés jusqu’au bout… J’ai travaillé aussi pendant un certain temps dans un centre de rééducation fonctionnelle. Là je n’ai pas eu affaire à des personnes qui décédaient, mais j’ai connu le cas d’un monsieur qui était en état végétatif. Les soins palliatifs nous font nous interroger sur les limites de l’orthophonie. Des collègues, Agnès Brabant et Didier Lerond sont formés et travaillent en soins palliatifs. Il y a très peu d’orthophonistes qui le font mais ce champ d’intervention se développe et suscite de l’intérêt même parmi les étudiants en orthophonie. Un mémoire d’orthophonie sur les soins palliatifs est en cours à Besançon.
Que dire aux familles et au personnel qui pensent qu’on ne peut plus communiquer avec une personne qui se trouve dans un état végétatif ? La personne comprend-elle son interlocuteur ?
Oui la personne en état végétatif ou la personne très atteinte sur le plan cognitif communique et comprend autrui aux niveaux émotionnel et sensoriel, par exemple lorsqu’on la touche, à la voix…. Je me souviens d’une dame Alzheimer. Cette dame ne parlait plus mais appréciais les moments orthophoniques. Je lui lisais des histoires. Elle avait été professeur de français et aimait beaucoup la littérature, mais elle ne pouvait plus lire du tout. Elle avait réagi à une phrase par une mimique d’expression, qui prouvait que quelque chose était passé, et aimait les textes que je lui lisais… Mes collègues qui travaillent en EHPAD le disent bien, on n’est pas sur du langage, on est sur de la communication, quelle qu’elle soit. Je repense à un monsieur que je suis allée voir hier, il ne réagit presque pas, et sa femme lui parle mais n’obtient jamais de réponse ni de réaction… Elle pensait que l’orthophonie allait permettre de faire des progrès… En concertation avec le médecin, je suis allé voir ce patient. Après avoir observé ce monsieur, j’ai parlé à sa femme. Elle a pu poser des questions, confronter ses observations aux miennes et comprendre que la rééducation orthophonique ne pourrait pas permettre de récupérer du langage. Nous avons parlé de communication, ce qui lui a permis d’être assurée qu’elle faisait au mieux. Ce qui est important pour elle, c’est qu’elle continue à communiquer avec son mari à sa façon. On a parlé d’elle aussi, j’ai voulu savoir comment elle vivait tout cela et comment elle se situait dans leur histoire, quel sens elle donnait aux soins qu’elle donnait à son mari. Ce patient et sa femme, je vais continuer à les accompagner, pas forcément toutes les semaines, mais il ne faut pas les laisser tomber.
Je peux comprendre que certaines collègues ne suivent pas ce genre de patient jusqu’au bout, mais ça se discute avec le patient et ses proches, ou alors il ne faut pas lâcher les gens comme ça, il faut trouver quelqu’un qui prenne le relais, quelqu’un qui peut ne pas être un autre professionnel. Par exemple les aides-soignants en EHPAD jouent un rôle très intéressant : elles-ils sont là tous les jours, elles-ils sont très observateurs, elles-ils ont besoin d’être reconnus et valorisés dans leur rôle de soignant…
Pour en savoir plus, retrouvez l’ouvrage de Mireille KERLAN : Éthique en orthophonie, Le sens de la clinique.
Labortho est aussi sur Facebook !
N’hésitez pas à partager vos commentaires.




